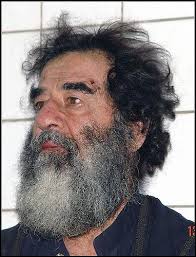Les choses commencent à s’éclairer. Il n’y a pas de lien, comme nous l’avons vu, entre le rapport du PNAC de 1999 et les attentats du 11 septembre 2001. Nous allons voir dans ce dixième et avant-dernier chapitre que la guerre de libération de l’Irak , comme chacun sait, n’a aucune espèce de rapport avec ces événements.
Nota Bene : Donald Forestier est un auteur fictif inventé pour imiter le style des apôtres de la version officielle des attentats du 11 septembre 2011 dans les grands médias.
Il est probable que je ne me fasse pas que des amis dans ce chapitre. Ce que je m’apprête à faire, c’est la remise en cause, ni plus ni moins, de la position de la France en 2003 lors de la préparation de la guerre de libération de l’Irak. Quand on entend les conversations aujourd’hui, c’est une position sur laquelle nul n’a l’idée de revenir. “Nous avons été bien avisés de ne pas nous embarquer dans cette aventure, nous avions vu juste pour les armes de destruction massive, Villepin a fait un superbe discours.” Voilà ce que pensent et se disent la plupart des gens.
Seule m’intéresse la vérité. Les truthers se servent de cet épisode pour tenter de convaincre l’opinion que les États-Unis ont aussi menti pour les attentats du 11 septembre. Le “mensonge irakien” étant à sa façon énorme, il est vrai, je conçois sans peine que ces âmes perdues se soient ruées sur ce mirage pour forger un de ces amalgames dont ils ont le secret. En m’aventurant dans le détail du “mensonge irakien”, j’ai réalisé, pour reprendre une expression de Bernard Kouchner, fervent partisan à l’époque du renversement de Saddam Husseïn, à quel point cette position était “enfantine”.
L’ « affaire » irakienne est impossible à comprendre si l’on met de côté les quatre décennies troublées qui la précèdent.
Ainsi, pour introduire mon sujet, je vais commencer par retracer l’histoire de l’Irak depuis l’accession au pouvoir de Saddam Husseïn en 1968, à son renversement en mars 2003, en passant par la guerre Iran/Irak de 80/88, et la première guerre du golfe de 1991.
Sommaire
Les débuts compliqués de la relation entre les États-Unis et Saddam Hussein
Comme l’un de ses sympathiques pères spirituels, Adolphe Hitler, c’est au bout de sa troisième tentative de coup d’état (après celles de 1958 et de 1964) que Saddam Husseïn accède au pouvoir avec ses compagnons du parti Baas en juillet 1968. Il n’a pas encore le titre de président, mais dès cette époque c’est l’homme fort du régime, puisqu’il a d’emblée la bonne idée, à l’âge de 31 ans, de briguer avec succès la direction des services de renseignement. Depuis cette position, qu’il sait favorable grâce à sa connaissance du fonctionnement du parti communiste soviétique, un autre de ses modèles, il élimine ses rivaux les uns après les autres, et devient rapidement le seul maître à bord. Cette ascension régulière et méthodique trouve sa consécration en 1982, lorsqu’il accède à la présidence de la République.
Les États-Unis, conformément à leur instinctif respect des valeurs de la démocratie et de la liberté, n’avaient à l’époque aucune considération pour l’Irak de Saddam Husseïn, qu’ils avaient inscrit sur la liste des états terroristes, quand ce dernier eut l’idée funeste de rejoindre le camp du côté obscur de la force, à savoir L’URSS. Et ils l’auraient très certainement dès cette époque balayé de la scène géopolitique si un événement aussi terrifiant qu’inattendu ne s’était produit : je veux parler de l’accession au pouvoir en Iran de l’imam Khomeiny, en 1979, et de la mise en place dans l’ancienne Perse d’un insupportable et anachronique furoncle de régime politique : la théocratie islamique. Entre cette peste et ce choléra, les Etats-Unis étaient face à un choix cornélien.
Peut-être sont-ce les valeurs laïques dont pouvaient par ailleurs se prévaloir Saddam Husseïn qui firent peser la balance dans son sens. La France (avec presque tous les pays européens) était l’amie fidèle de Saddam à cette époque, et l’Irak était le seul pays arabe à prendre un chemin en apparence comparable au sien. Sans doute aussi les États-Unis étaient-ils rassurés par le refroidissement des relations irako-soviétiques, après l’exécution en 1978 par Saddam Husseïn d’une vingtaine de dirigeants du parti communiste irakien. Je n’oublie bien sûr pas l’expérience humiliante de l’occupation de l’ambassade des Etats-Unis à Téhéran en novembre 79, et de la prise d’otages de 63 de ses employés, qui ne prit fin qu’au bout de 444 jours, et causa la rupture des relations diplomatiques entre l’Iran et les Etats-Unis.
L’Irak de Saddam devint alors plus fréquentable.
La guerre Iran/ Irak et la lune de miel irako-étasunienne
L’Irak fut retiré en 1982 de la liste des états terroristes. C’est Donald Rumsfeld, alors secrétaire d’état de Reagan et envoyé spécial du président, qui fut chargé l’année suivante d’aller à Bagdad pour renforcer les relations diplomatiques et remettre à Saddam Husseïn une lettre du président Reagan l’assurant que “la victoire de l’Iran contre l’Irak nuirait gravement aux intérêts des États-Unis.”
Cette rencontre marqua le commencement de ce qu’on pourrait appeler, sans trop exagérer, la lune de miel irako-étasunienne. Dès lors que les États-Unis décidèrent de donner un coup de main à Saddam, le but étant la destruction du régime iranien, d’alliés fondamentaux nous passâmes au second plan. Incontestablement, nous avions trouvé beaucoup plus fort et séduisant que nous ; lorsque les États-Unis se mettent en tête de s’occuper de quelque chose, la chose en question n’a plus vraiment besoin d’aide supplémentaire. Pendant la guerre Iran/Irak les États-Unis aidèrent l’Irak dans tous les domaines. Ils lui vendirent les souches de la peste bubonique et de l’anthrax, ainsi que de l’insecticide susceptible d’entrer dans la composition d’armes chimiques. Ils le fournirent en armes de toutes sortes, notamment en hélicoptères capables d’épandre ces produits mortels. William Casey, ancien directeur de la CIA, monta une société-écran chilienne pour approvisionner Saddam en bombes à fragmentation. Les USA lui accordèrent des prêts garantis pour lui permettre de soutenir son effort de guerre et nourrir sa population. Le montant de ces prêts oscillait entre 500 millions et un milliard de dollars par an, et fut poursuivi jusqu’à la veille de l’invasion du Koweït en 1990.
Les Étasuniens, à l’époque, ne se cachaient pas des raisons qui les poussaient à soutenir l’Irak. En janvier 84, Richard Murphy, secrétaire d’état adjoint aux questions du Proche Orient et de l’Asie du sud, suggérait dans un mémo de fournir l’Irak en camions poids lourds, en ambulances blindées, en matériel de communication, et proposait d’aider à construire un pipeline permettant d’acheminer le pétrole au port jordanien d’Aqaba, pour contourner le blocus naval de l’Iran. Pas plus tard que le 2 octobre 1989, George Bush père, le président en poste, déclarait : “Des relations normales entre les États-Unis et l’Irak servent nos intérêts à long terme dans la région et jouent en faveur de la paix, à la fois dans le Golfe et au Proche Orient. Les États-Unis proposent des mesures économiques et politiques susceptibles d’inciter l’Irak à améliorer son comportement et d’accroître notre influence sur ce pays… Nous devons continuer, et travailler à ouvrir aux multinationales américaines les opportunités de participer à la reconstruction de l’économie irakienne.”
Cette énumération impressionnante pour ceux qui ont oublié l’horrible parenthèse de la guerre Iran/Irak, qui fit quand même un million de morts, dont les trois quarts du côté iranien, ne donne cependant pas encore toute la mesure du soutien et de l’indulgence des États-Unis pour le régime irakien. Le lecteur se souvient de l’argument invoqué quotidiennement par Rice, Cheney, Bush, Rumsfeld, et autres hauts responsables étasuniens, dans la phase de préparation de la guerre en 2003 : “Rendez vous compte, quelqu’un qui non seulement possède des armes de destruction massive, mais qui va jusqu’à les utiliser contre son propre peuple !” Ce n’est pas ainsi que les États-Unis réfléchissaient à l’époque. Dès novembre 1983, les services secrets savaient que Saddam faisait un usage quasi quotidien des gaz de combat contre l’Iran. Quatre mois après le massacre de Halabja en 1988, qui vit périr 5000 civils kurdes en une poignée d’instants des effets du gaz moutarde, les USA aidèrent les Irakiens à construire une usine leur donnant la possibilité de construire leurs propres armes chimiques.
Cette affaire de Halabja fut tout de même difficile à banaliser. Certains sénateurs s’émurent fortement du caractère odieux du forfait et voulurent le qualifier de génocide, de façon à pouvoir soumettre l’Irak à un régime de sanctions. Cette proposition rencontra un écho très favorable aux États-Unis, tant l’épisode, largement relayé par les médias, avait suscité l’émotion dans l’opinion publique. Mais les hommes clés de l’administration Reagan de l’époque, Dick Cheney et Colin Powell, se dressèrent vent debout contre cette initiative, qui fut en fin de compte rejetée, le porte parole de la Maison Blanche qualifiant le régime en place de “seul légitime”.
Ceux qui croient que la colère des États-Unis couvait depuis longtemps, n’attendant qu’un casus belli pour éclater en pleine lumière, en sont donc pour leurs frais. C’est en fait jusque dans les derniers instants précédant l’invasion du Koweït en 91, que les Américains demeurèrent le soutien fidèle de Saddam Husseïn. C’est avec une extraordinaire soudaineté, dans le plus inattendu et le plus entier des renversements, que les Étasuniens se mirent à voir dans le chef de la jeune nation irakienne, rempart laïc contre l’islamisme fondamentaliste, l’ennemi public numéro un : “l’infâme et répugnant saligaud, honte du genre humain qu’on signale partout au long des siècles, dont tout le monde a entendu parler, ainsi que du Diable et du Bon Dieu, mais qui demeure si divers, si fuyant, insaisissable en somme. ”( Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, chapitre 3)
Le tournant de l’invasion du Koweït
Les Étasuniens étaient si peu conscients de ce que tramait Saddam Husseïn, que lorsque ce dernier, une semaine avant l’invasion du Koweït en 1990, vint rendre visite à l’ambassadeur des États-Unis en Irak April Gladyes, pour savoir de quel œil ils envisageaient une éventuelle invasion du Koweït par les chars irakiens, ce dernier se contenta de répondre que « les États Unis n’avaient pas de position sur la question ». Sans doute pensait-il que Saddam faisait une blague, ou qu’il comptait soulager par la parole ce qu’il n’oserait plus jamais traduire en actes après la pénible expérience iranienne.[1]
C’est, encore aujourd’hui un sujet d’étonnement pour moi que les États-Unis ne l’aient pas pris au mot. Saddam Husseïn ne manquait pas d’arguments pour se lancer dans cette aventure. Il accusait son petit voisin de dépasser ses quotas de production de pétrole, et de contribuer à la dépréciation des cours de cette matière première, ce qui privait l’Irak de rentrées de devises dont il avait cruellement besoin après la guerre de huit ans qui avait saigné à blanc les finances du pays. L’Irak avait en particulier une ardoise de 15 milliards de dollars envers ce petit pays, que l’attaque lui eût permis d’effacer d’un trait. Saddam Husseïn n’avait jamais reconnu l’indépendance du Koweït, qu’il considérait comme partie éternelle et inaliénable du “Nouvel Empire Babylonien” qu’il rêvait de reconstituer. De surcroît, la CIA, qui avait fourni à Saddam Husseïn pendant la guerre Iran/Irak d’innombrables photos satellites montrant les positions adverses, savait bien que Saddam Husseïn avait amassé soudainement, près de la frontière, une quantité de troupes énorme et tout à fait inhabituelle. Peut-être les Étasuniens ont-ils un goût si prononcé pour les manœuvres militaires (voir chapitre suivant), qu’ils ont regardé cet amassage comme un exercice de routine, dont Saddam était à la fois friand et coutumier.
La première Guerre du Golfe
On comprend mieux sous cet éclairage, la grossièreté de la campagne de relations publiques orchestrée par le gouvernement américain à l’époque, avec l’aide de la société de communication “Hill and Knowlton” qui monta le fameux casus belli qui émut le monde entier, à savoir le faux témoignage bouleversant de la jeune fille qui “révéla” devant le conseil de sécurité des Nations Unies que des soldats irakiens avaient fait irruption dans une maternité koweïtienne, et avaient extrait tous les nourrissons des couveuses, pour les laisser périr à même le sol.
Le coup de force de Saddam avait pris totalement de court les Étasuniens ; ceux-ci, pressés par l’indignation, avaient été contraints de trouver un moyen à la va-vite pour convaincre l’opinion internationale de la nécessité d’intervenir pour défendre les Droits de l’Homme dans cette région du monde.
A vrai dire, je doute que ce mensongeounet (comparé à celui de 2003) ait été déterminant pour le montage de l’opération “Desert Storm”. Les gens avaient été choqués par cette invasion brutale d’un petit pays par un gros, et la sinistre réputation de Saddam était à cette époque déjà bien assise dans l’opinion. Je ne suis pas convaincu que l’indignation ait eu besoin de ce levain, finalement, pour décider toutes les démocraties du monde à s’allier pour punir l’Irak. C’est vrai que c’est particulièrement vil d’envahir un pays sans aucun motif valable, sinon celui de la raison du plus fort.
Le scénario de la “Première Guerre du Golfe” est bien connu. Toutes les démocraties du monde mobilisèrent leurs ressources militaires les plus modernes, élaborèrent une gigantesque machine de guerre de près d’un million d’homme, et trois semaines suffirent à cette “étoile de la mort” pour atomiser une armée pourtant présentée avant le début des hostilités comme la quatrième du monde.
Pourquoi les Étasuniens ne poussèrent-ils pas jusqu’au bout leur avantage ? Pourquoi se contentèrent-ils de libérer le Koweït et laissèrent-ils en place le régime de Saddam Husseïn ? Ils avaient pourtant appelé les populations chiites et kurdes à se révolter pour déborder Saddam par l’intérieur. Trop heureuses de saisir enfin une occasion de renverser le Staline mésopotamien, celles-ci ne se firent pas prier deux fois, se révoltant dès que le signe de l’invasion fut donné et que les premiers marines débarquèrent sur le littoral koweïto-irakien.
Parvenus à deux cents kilomètres de Bagdad, les Alliés refusèrent de pousser plus loin. Après avoir mis en déroute l’armée de Saddam, ayant occis dans la ruée une petite centaine de milliers de soldats irakiens, ils s’arrêtèrent, et rebroussèrent chemin. Après une humiliation aussi sévère, et connaissant le tempérament sanguin et belliqueux de Saddam Husseïn, il était pourtant à prévoir que ce dernier reporterait sa folie meurtrière sur les ennemis de l’intérieur qui avaient prétendu contribuer à l’abattre. 30000 d’entre eux allèrent rejoindre les fosses communes après les persécutions et les tortures les plus cruelles.
Pour être juste, il faut reconnaître que c’est une faute morale d’avoir laissé croire aux Chiites et aux Kurdes que nous allions aller jusqu’au bout ; mais il est vrai que les Alliés (notamment les Étasuniens, qui avaient tout de même leur mot à dire) n’étaient pas encore d’accord sur le sort qu’il fallait réserver à Saddam. Peut-être tout simplement que, comme les Alliés faisaient route sur les chapeaux de chenille vers Bagdad, ces dix longues années d’amitié qui les avaient liés à Saddam leur revinrent soudain à l’esprit. Il y avait quelque chose de trop énorme à destituer Saddam un mois seulement après lui avoir assuré que nous ne lèverions pas le petit doigt pour protéger le Koweït, et que nous souhaitions approfondir notre relation avec lui. Manquant des lumières nécessaires, je ne tenterai pas d’éclairer plus nettement cet épisode un peu trouble de la Première Guerre du Golfe.
De la libération du Koweït à la libération de l’Irak
Deux zones d’interdiction de vol furent décrétées, au nord et au sud du pays, et l’exportation de pétrole irakien fut soumis à des restrictions sévères. Le pays fut contraint d’accepter des inspections régulières de l’AIEA, auxquelles Saddam se plia avec la plus mauvaise grâce du monde.
Cette écrasante pression ultérieure, laquelle fut maintenue toute la décennie suivante jusqu’à la seconde invasion de 2003, montre bien que les Étasuniens s’en voulaient un peu de ne pas avoir terminé le travail, qu’ils étaient taraudés par un sentiment d’inachevé. Je rappelle une phrase du rapport du PNAC citée au précédent chapitre : “ Mettre fin aux opérations de survol reviendrait à offrir à Saddam Hussein une grande victoire, ce à quoi répugnerait tout dirigeant américain.”(p 15).
Ai-je besoin de faire un dessin au lecteur, après cette longue introduction historique ? La bouture avec le chapitre précédent est d’une simplicité enfantine. En 1996, le PNAC fut fondé précisément afin de faire émerger la solution la plus rapide pour évincer une bonne fois pour toutes Saddam Husseïn du pouvoir. Ce rapprochement devient évident quand on s’aperçoit que d’un bout à l’autre de l’histoire, ce sont toujours les mêmes officiels étasuniens que l’on retrouve sur le devant de la scène. Ceux qui ont écrit le rapport du PNAC sont les mêmes qui vendaient des armes de destruction massive à Saddam sous Reagan pendant la guerre Iran/Irak, les mêmes qui ont accédé à de hauts postes dans l’administration Bush I et II, les mêmes qui ont orchestré la campagne de relations publiques qui a vendu à l’ONU la nécessité d’aller régler définitivement son compte à Saddam Husseïn, les mêmes, enfin, qui ont déclenché la Deuxième Guerre du Golfe, et fini le travail.
Les Étasuniens en général, et les néoconservateurs au pouvoir en particulier, avaient tellement l’objectif irakien à l’esprit, que dès le 11 septembre 2001, certains cherchèrent hâtivement à trouver un lien entre l’événement du jour et Saddam Hussein. Donald Rumsfeld, très motivé, invita à porter le regard du côté de la Mésopotamie trois heures seulement après l’effondrement des tours jumelles. Le lendemain, eut lieu une réunion entre George W Bush, Richard Clarke, Colin Powell, et le même Rumsfeld. L’objet de cette réunion était de définir la cible prioritaire pour tirer vengeance de cet acte effroyable, les États-Unis s’étant déclarés en guerre la veille à 18 heures. A cette occasion, Rumsfeld réitéra la suggestion qu’il avait faite la veille de profiter de l’occasion pour se débarrasser de Saddam Husseïn. Comme argument, il avança notamment que “les cibles potentielles étaient infiniment plus nombreuses en Irak qu’en Afghanistan.”
Avec raison, ses frères néoconservateurs, qui avaient la tête un peu plus froide, lui signifièrent la difficulté qu’il y avait à faire précocement un lien si peu avéré. Clarke fit remarquer : “les États-Unis ayant été attaqués par Al Qaida, bombarder l’Irak de Saddam Husseïn serait tout aussi fondé que d’envahir le Mexique en réponse à l’attaque japonaise sur Pearl Harbour”. Powell trancha la question en concédant que si les États-Unis devaient envahir l’Irak, il était indispensable que “l’opinion fût auparavant préparée de manière convenable.”[2]
J’imagine qu’après ces judicieux conseils, Donald Rumsfeld parvint à se calmer un peu et se rendre aux raisons de ses collègues et amis, qui, sur le fond, de toutes les manières, partageaient la même opinion : il fallait seulement trouver des preuves solides, et monter une campagne de relations publiques efficace pour vendre au mieux le projet. Dans tous les cas, l’invasion ne l’Irak ne pouvait survenir qu’après celle de l’Afghanistan.
Quand on constate la difficulté qu’il rencontra pour convaincre le conseil de sécurité de l’ONU, on est obligé de reconnaître que Colin Powell fut visionnaire lorsqu’il fit remarquer à Rumsfeld que les liens entre Al Qaida et Saddam Husseïn étaient des plus ardus à établir. Et dire qu’à cette époque il n’avait même pas l’argument des armes de destruction massive en tête !
Les armes de destruction massive : un Casus Belli contesté
Le drame des Etats-Unis dans cette histoire irakienne, c’est, que, ayant vendu pendant dix longues années et en très grandes quantités à l’Irak des armes de destruction massive de toutes sortes, et connaissant le goût de Saddam pour ces engins de mort, ils étaient intimement persuadés que ce dernier en avait forcément gardés en réserve, ou n’avait absolument pas renoncé à en fabriquer. “Trouver des preuves d’armes de destruction massive ? Un jeu d’enfant ! Il n’y aura qu’à se baisser une fois sur place pour les ramasser.”, devaient penser les membres de l’administration Bush avant de lancer leur campagne de relations publiques.
Ce dut être une surprise immense et infiniment désagréable lorsqu’ils s’aperçurent que la réunion de preuves à présenter à leurs alliés, qu’ils se figuraient comme une formalité, relevait en fait de la “mission impossible”. La CIA fut envoyée aux quatre coins du monde, où elle remua ciel et terre, pour un résultat qui était le même à chaque fois : il n’existait pas de preuve de la détention d’armes de destruction massive par Saddam Husseïn
Quant aux liens supposés entre Al Qaida et Saddam Husseïn, les avertissements de l’agence furent encore plus cinglants : “Entre le laïc Saddam et le religieux Ben Laden, il existait autant de possibilités de mélange qu’entre l’eau et l’huile.”
A partir d’un certain seuil critique, Les États-Unis furent mûrs pour prendre pour argent comptant n’importe quelle preuve, pourvu qu’elle leur fournît la base suffisante au déclenchement d’une guerre.
Seul le besoin désespéré des Étasuniens de trouver les arguments dont ils avaient besoin explique que des personnes aussi structurées intellectuellement que Cheney, ou Rumsfeld, aient pu ajouter foi aux affabulations d’un camelot aussi lamentable et douteux qu’Ahmed Chalabi et son Iraki National Congress (INC).
S’aventurer dans le détail de « l’affaire Chalabi » mériterait plusieurs volumes, et c’est avec frustration que je me limite à ce survol lapidaire.
Se fondant sur des informations truquées par Chalabi et des documents transmis par les services de renseignement britannique sur la détention d’ armes de destruction massive par Saddam, les membres les plus hauts placés de l’administration Bush n’eurent de cesse pendant les dix huit mois qui précédèrent la “libération de l’Irak” de “préparer”, pour reprendre l’expression de Colin Powell, l’opinion étasunienne au caractère inéluctable d’une invasion de l’Irak, en accusant Saddam d’avoir acheté de l’uranium au Niger, ou de pouvoir déployer des armes de destruction massive en moins de 45 minutes.
“La seule figure de style valable étant, selon Napoléon, la répétition”, les membres de l’administration Bush s’attachèrent à matraquer quotidiennement les mêmes argumentaires aveuglément repris de Chalabi. Bush, Rice, Cheney, etc, furent omniprésents dans les médias les mois qui précédèrent l’invasion, donnant à force autorité à des faits que personne ne ressentit plus le besoin d’aller vérifier.
S’il n’y avait eu que l’opinion américaine à convaincre, l’affaire aurait été entendue, mais une épreuve plus difficile s’annonçait. Notre président de l’époque, Jacques Chirac, réussit à installer dans l’opinion mondiale, après une campagne de propagande rondement menée, l’idée de la nécessité d’un débat à l’ONU sur la question irakienne. Les autres habitants du monde n’ayant pas été “préparés” correctement, des doutes s’exprimèrent. Le chancelier Schröder déclara ne pas vouloir suivre les États-Unis dans leurs “aventures”. La France monta en première ligne pour contester les preuves d’existence d’armes de destruction massive sur le sol irakien. Deux camps se formèrent, celui des faucons (avec à leur tête les Étasuniens et les Britanniques), et celui des colombes (parmi lesquelles on comptait des gens comme Khadafi, Poutine, et Bashar el Assad). Powell se ridiculisa avec sa petite éprouvette et son powerpoint sur les laboratoires mobiles, lors de son intervention alarmiste à l’ONU. Dominique de Villepin produisit un discours dans une veine très gaulliste, qui signa notre fracassant retour sur la scène internationale. Jacques Chirac brandit la menace du veto. Blair s’indigna. Bush intima à Saddam Husseïn et ses fils de quitter l’Irak dans les quarante huit heures. L’armée irakienne fut balayé en trois semaines. On ne trouva pas les armes de destruction massive, on finit par débusquer Saddam. On l’exécuta.
L’attitude honteuse et irresponsable de la France tout au long de l’affaire irakienne
Je me vois contraint de briser net l’impression que pourrait ressentir mon lecteur, en ce point du chapitre, que les États-Unis ont eu pendant près de trente années un comportement douteux.
“Avant d’enlever la paille qui est dans l’œil de ton voisin, enlève la poutre qui est dans le tien”, est-il dit dans l’Évangile selon Luc. Il se trouve que nous ne sommes pas, loin de là, les mieux placés pour donner des leçons puisque nous avons eu l’inconscience en 1976, sous l’impulsion du premier ministre Jacques Chirac, de vendre un réacteur nucléaire à un homme dont quand même deux trois faits et gestes nous indiquaient, fût-il laïc à notre instar, qu’il n’était pas le Mahatma Gandhi : la plus irresponsable de toutes les décisions, c’est nous, et personne d’autre, qui l’avons prise. Je profite de l’occasion pour remercier Israël d’avoir eu la lucidité de bombarder ladite centrale l’année suivant sa construction, en juin 1981.
En ce qui concerne nos positions plus récentes, à savoir la menace de veto brandie en 2003 par le même Jacques Chirac devenu président, je pense qu’il n’y a vraiment pas de quoi fanfaronner : si l’on prend pour critère décisif l’existence ou non d’un mensonge dans la campagne de relations publiques qui mène à la guerre, nous devons admettre que nous n’avions pas de raisons valables de participer à l’une ou à l’autre des deux guerres du Golfe. C’est bien sur la base de mensonges que chacune de ces deux guerres ont été déclenchées ! Notre position eut été cohérente si nous avions refusé de mordre à l’hameçon en 1991, ou si nous avions décidé de soutenir notre Allié en 2003. Résolus et peu regardants en 1991, nous nous sommes parés de la toge de la vertu en 2003. Peut-être à l’époque avions nous encore à l’esprit les avantages de cette doctrine si chère à Henry Kissinger que l’on nomme Realpolitik.
C’est un impair insigne que d’avoir abandonné les États-Unis dans une période où ils se remettaient tout juste de la plus meurtrière attaque de leur histoire sur leur sol. Nous n’avons même pas été capables d’aller jeter un coup d’œil dans le rapport du PNAC pour y trouver les racines profondes de leurs motivations et de leurs angoisses ; nous avons oublié la direction que nous avions prise douze ans auparavant. Nous n’avons même pas été capables de reconnaître l’occasion formidable que représentait la “Guerre Contre la Terreur” pour renverser un régime politique dont le centre n’était plus qu’à deux jets de missiles balistiques, puisque l’Afghanistan avait été envahi entre-temps, et qu’était disponible, prêt à l’emploi, l’immense appareil militaire étasunien tonifié par les crédits débloqués sous l’impulsion des membres du PNAC propulsés au pouvoir
Comme les auteurs du rapport “Reconstruire les Défenses de l’Amérique” ont eu du nez de moderniser et décupler les forces armées américaines, de façon à ce qu’elles puissent mener « deux guerres en même temps, sur deux théâtres majeurs d’opération ! (p 41) » Rendez vous compte ! Sans les réformes détaillées dans ce rapport, les États-Unis, une fois l’Afghanistan envahi, auraient sans doute été hors d’état de déclencher une seconde invasion, qui plus est contre un ennemi autrement organisé et armé que la pouilleuse et désargentée plèbe talibane.
Quant à nous, nous avons été complètement à côté de la plaque : trop enthousiastes à l’idée de sortir de l’arrière-cour géopolitique où nous étions remisés depuis la fin de la seconde guerre mondiale, nous avons saisi la première occasion qui se présentait depuis bien longtemps, en l’occurrence la blessure de notre ami le plus fidèle, pour redorer notre blason.
L’honneur de la France sauvé par les déclarations des membres du Cercle de l’Oratoire
Le Cercle de l’Oratoire est un cercle de réflexion français fondé peu après les attentats du 11 septembre 2001. Son dessein est de défendre dans l’opinion certains éléments de la politique étrangère des États-Unis. Ses membres, proches des néoconservateurs américains, dénoncent le dénigrement maladif dont font trop souvent l’objet les États-Unis en France, et les théories du complot qui se mettent à pulluler dès que les États-Unis se mettent à éternuer ou à se gratter.
Il compte parmi ses membres des personnalités issues du monde de la culture (Romain Goupil, Jacques Tarnero), des intellectuels (Pascal Brukner, André Glucksmann), des historiens (Stéphane Courtois, Max Lagarrigue),des chercheurs (Pierre André Taguief, Thérèse Delpech), et des hommes politiques chevronnés comme Bernard Kouchner : bref, des personnalités de premier plan qui sont en même temps des spécialistes reconnus dans leurs disciplines.
Rien n’était plus légitime et opportun que le renversement de Saddam Husseïn en 2003, et je considère, avec les membres du Cercle de l’Oratoire, que ce fut une faute très grave de faire faux bond à notre Allié, quelles que fussent par ailleurs les carences de l’argumentaire des néoconservateurs américains pour convaincre l’opinion mondiale de la nécessité de cette guerre.
Je veux profiter de l’occasion qui m’est donnée pour rendre hommage à deux prises de positions de membres éminents de ce cercle de réflexion. Elles furent rares à l’époque en France, les voix qui osèrent s’élever contre la manipulation populiste de Jacques Chirac et les rodomontades belamiesques de Villepin.
Je renvoie le lecteur à un article publié par André Glucksmann le 22 février 2003 dans le Herald Tribune International et qui avait pour titre « Les cinq péchés cardinaux de la France sur l’Irak ». Il s’agit d’un argumentaire en cinq points extrêmement percutant qui souligne nombre de hiatus que j’ai déjà évoqués dans ce chapitre, par exemple l’accueil dans le camp des Colombes de pays douteux comme la Libye, la Russie, et la Syrie, le défaut de courage politique des dirigeants politiques français et allemands, ou le trou de mémoire sur les forfaits passés de Saddam. Le texte est tellement bon que le comité de lecture du site du PNAC a décidé de le publier sur son site.
Bernard Kouchner, autre membre éminent de ce cercle, et ministre des affaires étrangères du président Sarkozy, dans son style au pathétique inimitable, a fait à l’époque une déclaration qui mérite d’être citée in extenso :
“Depuis que j’ai découvert le sort affreux du peuple chiite et du peuple kurde, j’ai été irréversiblement hostile au régime irakien. Depuis 25 ans Saddam Husseïn fait régner la terreur dans ce pays. J’avais un devoir par rapport à ce que je savais. La parole irakienne est en train de se libérer. C’est dans des années qu’on jugera des bienfaits de ce renversement de régime. Quand on pense à ce que font les Russes en Tchétchénie… Le veto était un peu enfantin face aux américains. La France avait le devoir de ne pas mettre son veto et de retarder au maximum l’éclatement de la communauté internationale. Comment ose-t-on douter de la détention par l’Irak d’armes de destruction massive : faut arrêter avec ça ! Ça fait 20 ans que Saddam ne fait que ça ! Ce sont des gens qui n’y connaissent rien qui prétendent que l’Irak pourrait avoir tout arrêté et que les États-Unis sont des belliqueux. Il faut renverser Saddam Husseïn ! Les Kosovars disaient, comme les Irakiens diront plus tard : “Ce sont des bombes qui nous délivrent.””
Il conclut l’interview sur cette remarque déchirante : “C’est vrai que je me suis senti très seul dans ce pays…”
Quel dommage qu’à l’époque nous nous soyons focalisés sur les contradictions de l’administration étasunienne, et sur des détails sans importance comme la boiteuse démonstration de Powell à l’ONU . Si au lieu de cela nous avions accordé l’intérêt qu’elles méritent aux déclarations de personnes comme Kouchner ou Glucksmann, nous serions aujourd’hui en Irak, au côté des forces démocratiques, pour défendre les Droits de l’Homme que nous avons créés. Au lieu de cela, nous avons traîtreusement marqué contre notre camp… N’est-ce pas une des valeurs de l’amitié que de savoir passer à ses amis les écarts dans lesquels il leur arrive de tomber ?
Peut-être une guerre avec l’Iran nous permettrait-elle de renouer définitivement les liens distendus depuis cette époque avec l’Oncle Sam. Je fonde les plus grands espoirs sur la politique résolument atlantiste adoptée par notre président actuel, Nicolas Sarkozy. L’homme, à lui seul, a effectué un formidable travail de réconciliation qui n’est pas encore estimé à sa juste valeur par l’ensemble des citoyens français. C’est le propre des grands dirigeants que de savoir, dans les moments importants, prendre des décisions qui vont à l’encontre de l’opinion générale. L’histoire, j’en suis certain, lui rendra justice, de la même façon qu’elle finira par intégrer George Bush dans le panthéon des grands hommes envers qui l’humanité toute entière doit être reconnaissante, un de ces fameux “héros civilisateurs” dont les temps anciens donnent tant de modèles, Gilgamesh, Hercule, ou Romulus.
Donald Forestier
co-écrit avec Charles Aissani, sous le pseudonyme de Donald Forestier, publié sur le site Agoravox le 23 octobre 2010.
Notes
[1] « The Politics of Truth : A Diplomat’s Memoir : Inside the Lies that Led to War and Betrayed My Wife’s CIA Identity » écrit par Joseph Wilson en 2004
[2] « Against All Enemies : Inside America’s War on Terror » écrit par Richard Clarke en 2004